Sortir de la symbiose en se confrontant à la perte
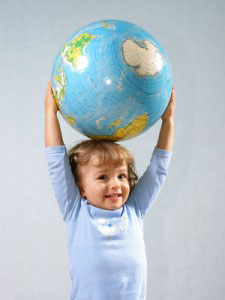
Le mot castration en psychanalyse rend compte « du processus qui s’accomplit chez un être humain lorsqu’un autre être humain lui signifie que l’accomplissement de son désir, sous la forme qu’il voudrait lui donner, est interdit par la loi ».
Cette signification passe par le langage, qu’il soit gestuel, analogique ou verbal. Cet interdit à agir renforce le désir, et provoque révolte puis dépression du fait de ne pouvoir obtenir satisfaction, et ensuite angoisse devant la menace d’annulation de son désir.
« C’est donc par interdit que le sujet désirant est initié à la puissance de son désir, qui est une valeur, en même temps qu’il s’initie ainsi à la loi, laquelle lui donne d’autres voies à l’identification des autres humains, marqués eux aussi par la loi ».
Les interdits ( inter-dits ) transmettent les grandes lois qui structurent l’identité de l’enfant au fur et à mesure de son développement : interdit du retour dans le ventre de la mère quand le cordon ombilical est coupé, castration originaire, ensuite l’interdit du cannibalisme par la castration orale lors du sevrage, puis l’interdit du meurtre par la castration anale, l’interdit de la toute puissance avec la castration phallique (qui est l’acceptation d’appartenir à un seul sexe), puis enfin l’interdit de l’inceste avec la castration œdipienne qui ouvre la voie du sujet au choix d’un objet d’amour hors de la famille, et à son identité symbolique dans son groupe culturel et social d’appartenance.
Ce n’est que lorsque les besoins de proximité sont satisfaits que l’enfant peut s’éloigner de la figure qui le sécurise pour explorer ce qu’il ne connaît pas.
Pour faire ce pas, D. Winnicott a conceptualisé la théorie de « l’objet transitionnel ». Cet objet symbolique de la présence maternelle ( bobine, doudou, etc..) permet à l’enfant d’exister séparé de sa mère, à condition toutefois que la mère soit « suffisamment bonne » c’est-à-dire, ni trop absente pour ne pas exposer son bébé à l’angoisse, ni trop présente pour ne pas entraver sa créativité et son autonomie.
Faute de quoi, cette mère que l’on dit irréprochable ou « trop bonne mère » deviendra à l’adolescence une mauvaise mère, car elle ne comprend pas pourquoi son enfant n’est pas dans la reconnaissance de tout ce qu’elle a fait pour lui.